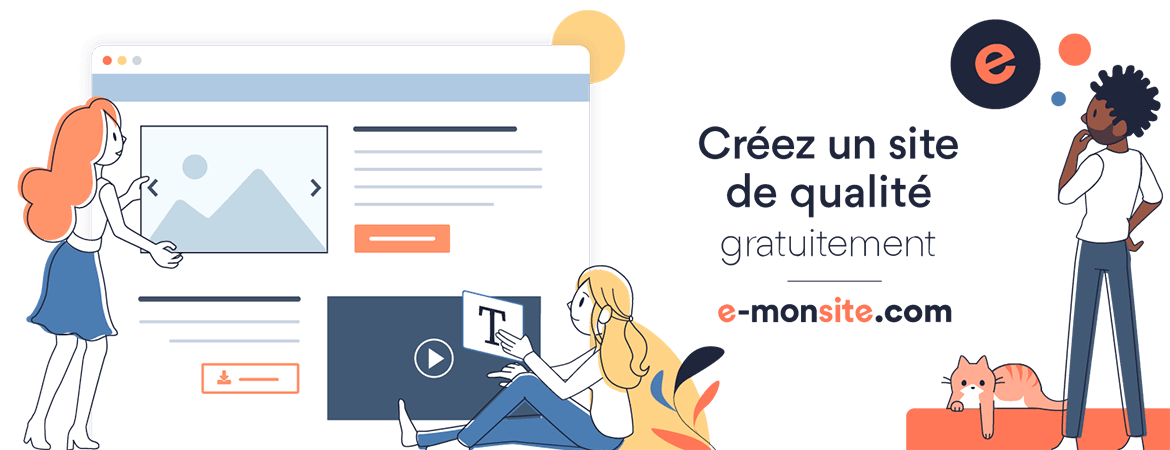Réminiscences
Nous avions tous vingt ans, et un peu plus peut-être,
Et nous ne savions rien des choses de la vie.
Nous étions des moutons que l’on amenait paître,
Nos bergers politiques étaient bien assoupis.
Ne sachant trop quoi faire, ils étaient tiraillés,
Conduisant au désastre, les yeux sur le baton.
Gouverner c’est prévoir, ce n’est pas louvoyer
Et nos beaux officiers, ne rêvant qu’aux … ratons!
Pour devenir plus tard les cocus de l’histoire.
Nous les pauvres couillons, on croyait à la guerre,
Victimes inconscients de nos esprits grégaires,
Car on voulait se battre, sans savoir trop pour qui,
Pour les colons bien sûr, leurs privilèges acquis,
Ils voulaient tout garder, en imposant leurs lois
Attisant les querelles, entre arabes et gaulois.
A Paris, à Alger, on faisait des patrouilles
Mais ailleurs se tramaient de vilaines magouilles,
Qu’importe le gâchis, et le sang et les larmes,
On ne faisait parler que la haine et les armes.
Le sort de l’Algérie se jouait à Wall Street
Au Caire et à Moscou, et non dans les guérites.
Oh! Que de temps perdu, que de vies sacrifiées,
Pour aucun bénéfice, que l’honneur humilié.
Telle est la tragédie dont nous fûmes acteurs.
Reste le souvenir d’une immense rancœur.
Il nous reste encore de beaux jours à vivre,
Même si Thanatos, avec sa grande faux
Rôde ici et là, et par monts et par vaux.
Disons-lui “halte là !”. Je termine mon livre.
Simon Garrigue, juin 2017
Vu par un ancien mobilisé, 60 ans après
Nous avions tous vingt ans, et un pau plus peut-être,
Et nous ne savions rien des choses de la vie,
Nous étions des moutons que l'on amenait paître.
Nos bergers politiques étaient tous assoupis,
Ne sachant plus quoi faire, ils étaient tiraillés,
Conduisant au désastre, les yeux sur le guidon.
Gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas louvoyer !
Et nos beaux militaires, qui craignaient l'abandon,
Assoiffés de revanche, ils rêvaient de victoires,
Pour devenir plus tard, les cocus de l'histoire.
Et nous, pauvres couillons, on jouait à la guerre,
Victimes nous étions, de notre esprit grégaire,
Car on voulait se battre, sans savoir pour qui:
Pour les colons bien sûr, leurs privilèges acquis:
Ils voulaient tout garder, en imposant leurs lois,
Attisant les querelles, entre arabes et gaulois.
A Paris, à Alger, on faisait des patrouilles,
Mais ailleurs se tramaient de bien tristes magouilles.
Qu'importent le gâchis, et le sang et les larmes
Si l'on ne sait parler que la haine et les armes.
Le sort de l'Algérie se jouait à Wall-Street (e),
Au Caire et à Moscou, non pas dans nos guérites.
Oh, que de temps perdu, les dés étant pipés !
Enfin nous sommes là, témoins et rescapés
Simon GARRIGUE (juin 2015)
Vaux-sur-Mer
Du même auteur, paru dans "Marianne" du 2 au 18 juin 2015

André Aussignac, appelé du 23e Rima à Alger, a été déclaré disparu le 21 juillet 1962 par l'Armée française
« Le soir du 21 juillet 1962, j'ai quitté, en uniforme, la Maison carrée (caserne) d'Alger pour aller acheter des cigarettes.Je suis tombé sur un barrage de musulmans en uniforme. Ils m'ont pris ma carte d'identité militaire et l'ont déchirée.
Je me suis retrouvé dans une camionnette avec des civils européens, dont le propriétaire du véhicule.
On a été conduits dans une briqueterie, déshabillés et jetés dans un four encore tiède. Dans la nuit, d'autres Européens sont arrivés. A la fin, on était 17. Nous sommes restés là, entassés, sans boire ni manger, à redouter qu'ils allument le four.
Au bout de quarante-huit heures environ, nous sommes partis en camion bâché.
Une fois dans le djebel, on nous a fait descendre et on a entamé une marche forcée de plusieurs semaines pour arriver à la mine de fer de Miliana.
Là, on nous a jetés à moitié nus dans une galerie. Dans la mienne, on était environ 60, mais il y avait d'autres galeries avec d'autres Européens. On nous obligeait à creuser avec des petites pioches.
On avait droit à un verre d'eau par jour et parfois à un plat de semoule.
Pour ne pas mourir de soif, on mettait nos slips dans les parois humides de la mine et on suçait les gouttes d'eau.
Quand le plat de semoule arrivait, on se battait comme des chiens entre nous.
Certains sont morts d'épuisement, d'autres se sont volontairement tués.
Une fois, l'un d'entre nous a planté sa pioche dans la terre et s'est jeté sur la lame.
Un jour, un ministre algérien est venu visiter la galerie. Je ne me suis pas levé pour le saluer.
Il m'a balancé un grand coup de pied dans la tête [la cicatrice à l'arcade sourcilière est encore visible]. J'ai essayé de m'évader deux fois sans succès.
La première fois, en représailles, on m'a donné de grands coups de bâton sur les chevilles.
La deuxième, on m'a assis sur une pierre, ligoté à un pieu et arraché les ongles des orteils avec une pince.La troisième tentative a été la bonne. J'étais avec deux autres copains qui ont été abattus. J'ai marché jusqu'à l'épuisement.
Des pieds-noirs m'ont découvert évanoui et nu dans un fossé.
Ils m'ont soigné, puis embarqué dans un chalutier en direction de Marseille.
Quand je suis arrivé chez moi, à Bordeaux, ni mes parents ni ma fiancée ne m'ont reconnu.
Je pesais moins de 40 kilos [contre 70 avant son départ]. Le 22 juillet 1963, j'ai été arrêté par la gendarmerie de Villeneuve-sur-Lot. C'était pendant mon voyage de noces.
On m'a interné au fort du Hâ pour "désertion en temps de paix" !
J'ai été brutalisé. On voulait que je livre les filières qui m'avaient permis de revenir d'Algérie. Je suis resté muet. On m'a ensuite conduit à l'hôpital militaire Robert Piquet. Sur la porte de ma chambre, on avait inscrit : "Individu dangereux" ,à ne pas mettre en contact avec les autres recrues".
Le tribunal militaire de Bordeaux m'a finalement acquitté.Je rends hommage au commissaire du gouvernement qui a plaidé pour ma non culpabilité.
Il a ensuite été muté.
En novembre 1963, le sénateur Etienne Dailly a évoqué mon cas au Sénat (Journal officiel du 24 novembre 1963, p. 2572).
Quelques jours auparavant, la Sécurité militaire m'avait menacé pour que je me taise.
Mon histoire gênait. Je me suis tu, jusqu'à aujourd'hui. La France a toujours su qu'il y avait et qu'il y a encore des prisonniers français civils et militaires depuis l'indépendance ; elle n'a jamais rien fait pour eux, la France nous a non seulement lâchement abandonnés, mais voilà comment elle m'a traité lorsque je suis revenu de cet enfer, j'ai honte pour la France
J'offre ce témoignage à la mémoire de mes compagnons qui ont été sacrifiés. »
Autre témoignage d'un appelé ordinaire
Comme beaucoup de soldats appelés, j’ai servi en Algérie en 1956 et 1957. Le régiment dans lequel j’étais affecté participait à la surveillance de tout un secteur dans l’Oranais entre Sidi-Bel-Abbès et Tlemcen. Mon escadron cantonnait dans deux fermes situées en plein bled. Nous avons changé plusieurs fois de cantonnement. Le plus au sud où je suis allé, c’est à 100 km au sud de Sidi-Bel-Abbès. C’est là que j’ai vu pour la première fois, les nomades logeant sous les tentes de tissu en poils de chameaux, les animaux paissant aux alentours.
Quelques semaines avant mon arrivée en Algérie, lors d’une opération après une série de fermes brûlées par les rebelles, un soldat rappelé avait été tué, et un sous-lieutenant blessé.
Sous-officier, je fus chargé plus particulièrement du ravitaillement et du service de vaguemestre pour l’escadron.
J’étais donc tous les jours sur la route, soit le matin, soit l’après-midi, me rendant à la poste militaire ou au service d’intendance, ou chez des commerçants avec lesquels nous passions des marchés. A cet effet, l’armée avait fait blinder un camion GMC, et parfois, mais rarement, je bénéficiais d’une escorte, ou bien un engin blindé m’attendait à un point statégique sur la route du retour, car les fellaghas avaient la fâcheuse manie de faire sauter les ponts enjambant les oueds, au passage d’un véhicule militaire. J’étais protégé: mon chauffeur, d’origine espagnole, s’appelait Jésus. Je lui avais cependant donné la consigne de traverser les ponts le plus vite possible. Je me souviens aussi du jour où notre GMC nous a laissés en panne, en haut d’un col boisé. Que faire ? se camoufler sous les arbres et attendre que l’on vienne à notre recherche: heureusement, aucun passage de rebelles ce jour-là !
Après mon travail au service du moral de la troupe, je participais occasionnellement aux patrouilles aux alentours. Personnellement je n’ai pas essuyé de coups de feu. Une fois, nous étions trois véhicules progressant doucement sous les arbres d’une forêt, quand un fellagha détala devant nous et disparut dans la forêt. Surpris sans doute alors qu’il faisait le guet, il n’avait pas eu le temps de lancer une grenade, ni de tirer sur nous. Nous ne l’avons pas retrouvé.
Le soir, j’avais souvent mission d’emmener une patrouille en embuscade, et de la récupérer aux environs de trois heures , à l’endroit où je l’avais déposée. A l’heure du rendez-vous, au plus noir de la nuit, lorsque j’entendais marcher sur la piste, sachant pourtant que ce ne pouvait être que les copains, une certaine appréhension me prenait à la gorge.
Quand tout l’escadron était parti en opération pour un ou deux jours, je restais à la ferme, pour organiser la garde de nuit particulièrement . Nous avions un petit dépôt de munitions et une réserve d’essence. Nous restions deux sous-officiers et moins de dix hommes. Il fallait faire des rondes très fréquentes pour rassurer ceux qui montaient la garde la peur au ventre, ou réveiller celui qui ne pouvait pas rester éveillé plus de 15 minutes !
Il est arrivé parfois qu’ un suspect soit ramené. Nous le gardions un jour, et le confions ensuite au PC du régiment.
Je garde le souvenir d’un beau pays que j’aurais aimé revoir ensuite. Il me reste l’image d’Algériens vivant pauvrement dans les zones rurales, plus aisément dans les petites villes; d’un certain Kabyle, tailleur de son métier, chez qui nous nous invitions pour boire le thé, et qui nous disait prier Allah pour que cesse cette guerre qui l’empêchait d’aller acheter ses tissus en France, comme il faisait auparavant; d’un certain Français d’origine alsacienne, qui avait épousé une Algérienne dont il avait de jolies jeunes filles, et qui se barricadait avec sa famille tous les soirs, dans sa ferme isolée à plusieurs kilomètres de celles où nous étions; d’Européens vivant de leur profession, comme en France, ni mieux, ni pire, étant coiffeurs, bouchers, cordonniers, marchand de glaces, cafetiers, etc.
Je me souviens de mon capitaine, un homme admirable , de certains sous-officiers de carrière ayant le sens du devoir, de tous mes camarades , inconscients et courageux. Tous ont fait leur devoir, comme on le leur avait demandé.
Comme la plupart d’entre nous, lorsque je suis rentré chez moi, il m’était impossible d’expliquer ce que j’avais vécu, ce que j’avais ressenti, parce que personne n’aurait compris.
Tous les ans je participe aux cérémonies commémoratives du 19 mars, date anniversaire de la cessation officielle des combats le 19 mars 1962. C’est pour rendre hommage aux 30 000 soldats français tués là-bas. C’est pour me souvenir de ceux que j’y ai vus blessés ou malades, qui partaient en opérations sans savoir s’ils en reviendraient, de tous enfin qui faisaient courageusement leur devoir. C’est pour honorer les harkis qui se battaient avec nous et que la France a abandonnés honteusement. C’est pour rappeler que beaucoup de civils ont payé de leur vie. C’étaient des chrétiens, des musulmans , des juifs, des athées. C’étaient des Français ouvriers, paysans, artisans, qui ont dû tout abandonner : leurs souvenirs, leurs amis, leurs biens. Ils ont été déracinés, rapatriés, et avec courage, ont reconstruit leur vie.
Toute guerre est haîssable car elle engendre des souffrances indicibles. C’est pourquoi je participe aussi aux cérémonies organisées aux dates anniversaires de proclamation de fin des combats, le 8 mai et le 11 novembre.
 Merci Albert pour ce document très intèressant qui nous rappelle notre jeunesse
Merci Albert pour ce document très intèressant qui nous rappelle notre jeunesse Super c'est à voir et à faire voir car beaucoup de détracteurs ne pensent pas à la triste réalité que fut la guerre d'Algérie, celle que nous avons connue et subie
Super c'est à voir et à faire voir car beaucoup de détracteurs ne pensent pas à la triste réalité que fut la guerre d'Algérie, celle que nous avons connue et subie merci Albert cela rappelle de bien tristes souvenirs mais fait aussi beaucoup de bien. Je parlerai de ce site à tous les copains de la section qui comme moi ne le connaissent encore pas. J'y ai même retrouvé la photo du bateau sur lequel j'ai fait le voyage MARSEILLE -CASA en MARS 1956. Merci
merci Albert cela rappelle de bien tristes souvenirs mais fait aussi beaucoup de bien. Je parlerai de ce site à tous les copains de la section qui comme moi ne le connaissent encore pas. J'y ai même retrouvé la photo du bateau sur lequel j'ai fait le voyage MARSEILLE -CASA en MARS 1956. Merci